Pathologie Ischémique
I) Généralités
L’ischémie ou, infarctus médullaire est une pathologie rare, qui engage, à court terme, le pronostic, aussi bien fonctionnel que vital du patient.Sa faible prévalence par rapport à l’ischémie cérébrale est principalement dûe au moindre volume de la moelle, les anastomoses longitudinales et transversales et à la rareté de l’athérosclérose des artères médullaires et des embolies médullaires [209].
L’ischémie médullaire représente environ 6% des myélopathies aiguës et environ 1 à 2% des pathologies vasculaires neurologiques [210].
Étiologies :
Plusieurs causes peuvent entrainer une ischémie médullaire ; elles sont différentes chez les enfants et les adultes.Chez les enfants, les étiologies les plus fréquentes sont les malformations cardiaques et les traumatismes.
Chez les adultes, athérosclérose est une des principales causes [190]. Cependant, d’autres étiologies peuvent être évoquées : anévrismes thoraco-abdominaux, chirurgie aortique, dissection aortique, hypertension artérielle, malformations artério-veineuses médullaires, prise de cocaïne, plongée sous-marine sans respect des paliers de décompression [212].
Localisation :
L’ischémie survient le plus souvent par occlusion de l'artère spinale antérieure. Les lésions ischémiques prédominent à l'étage thoracique inférieur ou au cône médullaire. La substance grise de la région lombosacrée est particulièrement sensible à l’ischémie.Elles sont plus rares au renflement cervical [214].
Les lésions sont le plus souvent bilatérales, prédominant en territoire central, au niveau de la substance grise et substance blanche adjacente. Les infarctus en territoire postérieur sont rares.
II) Clinique
L'ischémie artérielle médullaire doit être évoquée devant tout tableau médullaire d'installation brutale. La présentation clinique typique est la survenue d'une paraplégie flasque de survenue brutale associée à des douleurs intenses.Un syndrome douloureux est souvent associé à la paraplégie et aux troubles sphinctériens ou à la tétraplégie.
Les infarctus en territoire postérieur sont responsables au moins d’un syndrome ataxique.
La présentation clinique dépend principalement du siège et de l’extension de l’infarctus.
Le mode d’installation typique de la symptomatologie est brutal en moins de 4 heures ; avec un maximum d’intensité atteint dans les 12 heures pour 50% d’entre eux et, dans les 72 heures pour la majorité [215].
La sévérité des déficits est très variable ; de la faiblesse à la paraplégie. Une douleur rachidienne est souvent associée chez 70% des patients, habituellement au niveau de la lésion.
A) Syndrome spinal antérieur
Ce syndrome constitue la forme clinique la plus fréquente de l’infarctus médullaire.Il se manifeste typiquement par un déficit, sous-lésionnel, bilatéral, de la fonction motrice (para ou tétraplégie) et de la sensibilité thermo-algique ; contrastant avec sensibilité profonde peu affectée.
Le stade aigu est caractérisée par un déficit moteur flasque associé à une abolition des réflexes ostéo-tendineux. L’évolution, au cours des jours et semaines suivants, se fait vers la spasticité et l’hyper-réflexie [216].
Une atteinte des fonctions végétatives peut être associée. Elle se manifeste par une hypotension orthostatique, une dysfonction érectile, des troubles sphinctériens urinaires et/ou fécaux.
En cas de lésion cervicale haute, on risque une atteinte centre respiratoire.
Cas particulier : le syndrome spinal antérieur incomplet :
L’ischémie peut être limitée au niveau des cornes antérieure ; dans ce cas, la symptomatologie peut prendre la forme de :- Paraplégie aigüe sans déficit sensitif ni troubles sphinctériens.
- Diplégie brachiale douloureuse, en cas d’atteinte cervicale [217].
B) Syndrome spinal postérieur
Il est plus rare. Il entraine généralement, de manière bilatérale, des paresthésies et des troubles de la sensibilité profonde sous-lésionnels diffus. Et, une anesthésie complète au niveau lésionnel.Parfois, s’associent des déficit moteurs et spino-thalamiques, en cas d’extension antérieure de l’ischémie.
C) Présentations atypiques
- L’atteinte des artères sulco-commissurales se manifestera par un syndrome de Brown-Sequard incomplet, c’est-à-dire, sans atteinte de la sensibilité proprioceptive (sans atteinte coronale postérieure). Il comprend :
- Un syndrome pyramidal homolatéral, se manifestant par un déficit moteur spastique avec, hyper-réflexie ostéo-tendineuse et signe de Babinski positif.
- Un syndrome spino-thalamique controlatéral, se manifestant par un déficit sensitif sous-lésionnel, touchant la sensibilité thermo-algique et, épargnant les sensibilités tactiles et discriminatives.
- L’infarctus isolé du cône médullaire, peut se voir dans l’occlusion de l’artère d’Adamkiewicz. Il se traduit par des troubles sphinctériens, des troubles sensitifs dans le territoire des racines sacrées et un déficit moteur distal des membres inférieurs avec une aréflexie achilléenne.
- Les infarctus centro-médullaires, sont habituellement secondaires à une défaillance hémodynamique comme un arrêt cardiaque ou une hypotension artérielle prolongée.
La substance grise centro-médullaire est très sensible à l'ischémie.
Ces infarctus se manifestent par un déficit sensitif spino-thalamique bilatéral. Les troubles moteurs et sphinctériens sont généralement absents. - Infarctus transverses totaux de la moelle, se présente par une paraplégie ou tétraplégie, flasque, aiguë et brutale. Ils sont associés à des troubles sphinctériens et à une anesthésie complète sous-lésionnelle. Le pronostic fonctionnel est mauvais.
Ce type d'infarctus est le plus souvent lié à une origine embolique.
III) IRM
L’IRM médullaire est l’examen de choix pour le diagnostic de l’ischémie médullaire.Le début brutal du déficit neurologique nécessite une IRM en urgence. Les caractéristiques des infarctus médullaires sont proches de celles des infarctus cérébraux.
À l’IRM, les séquences indispensables sont [218] :
- Séquence T1 SE, en coupes sagittales.
- Séquences T2 SE et/ou T2 STIR, en coupes sagittales.
- En coupes axiales, on utilise des séquences T2* (T2 écho de gradient) au niveau cervico-thoracique et, T2 SE au niveau lombaire.
- Séquence de diffusion, en coupes axiales et sagittales.
- D’affirmer l’ischémie médullaire.
- Localiser le territoire de l’ischémie et préciser son étendue.
- Détecter certaines lésions associées, pouvant évoquer le diagnostic.
- Éliminer une autre cause (tumeur, hématome épidural, myélopathie autre qu’ischémique).
A) Aspects dans les 24 premières heures
Malgré un syndrome clinique très évocateur, l’IRM conventionnelle peut être normale, surtout en phase hyper-aiguë et pendant les premières 24 heures.À la phase aiguë, l'infarctus médullaire peut passer inaperçu car la lésion est en iso-signal T1 et, l’hypersignal en T2 n'est détectable qu'à partir de la 6ème heure.
Avant la 6ème heure, l'infarctus n'est donc pas visible avec les séquences conventionnelles en pondération T1 ou T2.
Cependant, l'IRM permet, dès lors, d'écarter d'autres causes de syndrome médullaire aigu, comme les compressions médullaires aiguës et les myélites aiguës.
Le diagnostic différentiel est facile avec les compressions médullaires aiguës, mais, à ce stade, il est souvent difficile avec les myélites aiguës [220].
En faveur d'un infarctus médullaire par rapport à une myélite à l’IRM :
- Une lésion de la partie antérieure de la moelle.
- Une lésion unique.
- Un infarctus associé du corps vertébral et une prise de contraste de la substance grise.
- Sans autre anomalie, y compris cérébrale.
En effet, la séquence en diffusion a déjà prouvé sa sensibilité et sa spécificité à la phase hyper-aiguë de l’ischémie en montrant, en coupes axiales, les lésions ischémiques en hypersignal
(Figure 68)
. [221]Son principal inconvénient réside dans sa difficulté d’utilisation par rapport à la diffusion au niveau cérébral. Et ce, en raison de la petite taille de la moelle, la faible résolution spatiale et, des artéfacts de flux du LCR.
Dû à l’œdème cytotoxique, l’ADC est d’abord abaissé puis se normalise en une semaine.
B) Aspects après 24 heures
Après 24 heures, l’œdème vasogénique est responsable de l’apparition d’une plage intra-médullaire à contours flous avec une possible tuméfaction médullaire focale.Cet œdème entraine un hyposignal T1, discret au début, qui devient plus facilement détectable après quelques jours, au sein d'une moelle augmentée de calibre.
L'imagerie T2 est plus sensible. Elle retrouve un hypersignal T2 sur les coupes sagittales, effilée en haut et en bas, « en crayon ». Il peut s’associer une tuméfaction médullaire focale [222].
Les coupes axiales pondérées en T2 permettent de distinguer la topographie antérieure ou postérieure de la lésion, systématisée à un territoire artériel :
- L’infarctus artériel spinal antérieur, de loin le plus fréquent, occupe les deux tiers antérieurs de la moelle.
Mais, souvent, la lésion prédomine dans le territoire central où elle peut être relativement limitée à la substance grise, donnant l’aspect dit en « oeil de hibou » ou en « tête de serpent »(Figure 69)
. [223] - L’infarctus du territoire spinal postérieur occupe les cordons postérieurs et la partie adjacente des cordons latéraux.
En phase subaiguë, un rehaussement est possible après injection de gadolinium, traduisant une rupture de la barrière hémato-médullaire.
Pendant cette phase, l'imagerie en tenseur de diffusion (utilisée qu’en milieu de recherche) peut apporter des éléments pronostiques en quantifiant la perte axonale et le retentissement de l'ischémie sur la microarchitecture médullaire.
Au stade tardif, quelques mois ou années plus tard, une atrophie focale de la moelle ainsi qu'une cavité intra-médullaire séquellaire peuvent être observées [224].
C) Signes associés
Les artères radiculaires et médullaires vascularisent également les vertèbres. En cas d’embolie, des lésions d’infarctus osseux de plusieurs corps vertébraux sont souvent associées.Les lésions touchent, le plus souvent, la partie antérieure du corps vertébral, mais également les plateaux vertébraux ou la région centrale.
L’infarctus vertébral se manifeste par une perte de l’hypersignal T1, normal des vertèbres.
En T2, apparait le plus souvent un hypersignal du corps vertébral.
L’association d’une lésion vertébrale et médullaire sans lésion épidurale ou méningée est très évocatrice de lésion ischémique.
Une ischémie musculaire peut aussi être associée à l’atteinte de la moelle épinière et des vertèbres ; elle se traduit par un hypersignal T2 STIR au sein des groupes musculaires intéressés.
×
![]()
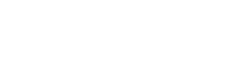
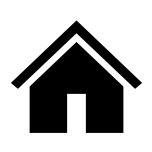 Accueil
Accueil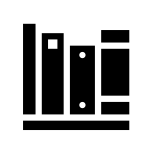 Bibliographie
Bibliographie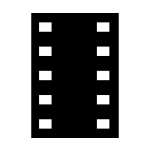 Galerie d'images
Galerie d'images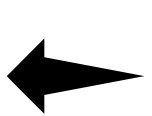 Précédent
Précédent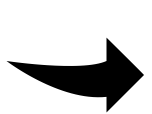 Suivant
Suivant 2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.
2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.